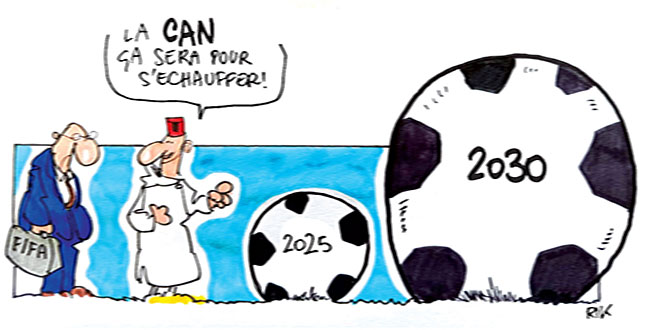Le 5 octobre 2017, le scandale éclate: le célèbre producteur hollywoodien Harvey Weinstein a, pendant des années, exploité et harcelé des femmes. Les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey écrivent à ce sujet dans le New York Times, l’actrice américaine Alyssa Milano partage l’article sur Twitter, et le hashtag #MeToo se propage et devient l’un des mots-clés les plus utilisés dans 85 pays. Différentes régions du monde, différentes langues, réunies par ces mots: «Me too».

Plus de deux ans auparavant, dans l’hémisphère sud, les femmes descendent dans la rue, criant «Ni Una Menos» («Pas une femme de moins»). Ce 3 juin 2015, la foule est dense autour du palais du Congrès de la nation argentine mais aussi en province. Dans les villes, les femmes dénoncent les féminicides, l’expression la plus extrême des violences sexistes. Des violences qui s’immiscent dans la vie quotidienne, camouflées ou pas, et qui ont une matrice: l’inégalité.
«On veut rester en vie». Ce cri se répand rapidement dans toute l’Amérique latine, et des manifestations ont lieu au Mexique, au Pérou, en Colombie et au Nicaragua. Au Chili, le collectif Las Tesis popularise la chanson Un violador en tu camino («Un violeur sur ton chemin»), inspirée par l’anthropologue féministe Rita Segato. On la chante alors jusque dans les capitales européennes, et même à l’intérieur du parlement turc. Les Polonaises, de noir vêtues, font la grève pour faire respecter le droit à l’avortement.
En 2016, la première grève nationale contre les féminicides a lieu en Argentine. Elle trouve un écho au Mexique, au Chili, en Bolivie, au Honduras, en France et en Espagne. Un an plus tard, la première grève internationale des femmes a lieu.
Mais Ni Una Menos, c’est plus qu’une dénonciation des féminicides. Le mouvement a révélé tout un système qui protège et normalise la violence. Pendant des décennies, il y a toujours eu des appels au changement, mais en 2015, c’est devenu quelque chose de plus répandu. Ingrid Beck, journaliste et soutien de la marche, estime que l’une de ses principales réalisations a été de faire comprendre au public que les féminicides sont le produit d’une inégalité structurelle. «En plus d’être la première marche massive pour les droits des femmes en Argentine, en Amérique latine et dans les Caraïbes, celle qui a fait du mouvement féministe un sujet politique, elle a également changé la façon dont sont perçues les violences sexistes en liant les féminicides aux inégalités structurelles. En plus de faire pression sur les pouvoirs publics, les revendications étaient également dirigées vers la société».
Beck souligne une énorme différence avec le mouvement Me Too. «Avec Me Too, l’idée était que la violence est transversale, qu’importe les origines socio-économiques, l’éducation ou l’endroit où l’on vit. Cela nous touche toutes, partout, que nous soyons privilégiés ou non. Me Too est devenu énorme dans le reste du monde, mais il a surtout condamné les abus sexuels commis par des personnes puissantes qui utilisaient leur position contre les femmes. Les agresseurs de Me Too sont Harvey Weinstein ou des dirigeants de multinationales, pas un mari anonyme qui est systématiquement violent à la maison. Sa femme n’a ni l’argent ni les réseaux dont disposent les actrices pour pouvoir dénoncer ces violences». Selon elle, en se concentrant sur des personnes puissantes, on néglige la matrice structurelle de la violence. «Me Too n’associe pas les violences sexistes au manque d’autonomie économique des femmes. Il n’y a pas de rapport. Ni Una Menos introduit l’idée que pour sortir du cycle de violence, il faut avoir des réseaux et une autonomie économique».
Mais même si Ni Una Menos est né et a conquis les rues plus tôt, le mouvement Me Too a eu une visibilité mondiale parce qu’il a démarré au cœur du show business. «Les époques sont différentes, mais leurs ondes ont la même fréquence, estime Pomeraniec. Ni Una Menos a eu une influence [sur Me Too], même si les gens ne le savent pas aux États-Unis. C’est l’esprit du temps, le climat d’une époque. Tout ce qui est venu après n’est pas le fruit du hasard.»

Aujourd’hui, près de huit ans après la première mobilisation du mouvement argentin, on observe la montée d’une forte réaction conservatrice contre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+s. Certains leaders conservateurs expriment ouvertement leur mépris pour les avancées législatives qu’il a pu y avoir et encouragent leur suppression. Pour la sociologue féministe Danila Saiegh, c’est lié au fait que le mouvement a cessé d’être marginal, qu’il a davantage de revendications et, que dans plusieurs pays, il s’est fait une place au sein des institutions. En Argentine, par exemple, le ministère de la Femme, du Genre et de la Diversité a été créé en 2020.
«Au début, nous parlions simplement de ne pas être tuées, et c’était très difficile pour les personnalités publiques de s’y opposer car c’était si élémentaire comme demande, explique Saiegh. Plus tard, ils ont commencé à voir que le féminisme va bien plus loin que cela, et qu’il concerne de nombreuses questions, comme le débat sur l’avortement. Cela dérange beaucoup de gens. Un grand nombre de personnes et d’institutions puissantes ont commencé à être très agacées, et des idéologies qui semblaient dormantes se sont mises en éveil. Davantage de catholiques, de conservateurs et de personnes d’extrême droite ont gagné en popularité dans certains secteurs de la société». Parmi les plus connus, il y a l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, l’ancien président américain Donald Trump ou encore la première ministre italienne Giorgia Meloni. «Pour beaucoup, le féminisme appartient désormais à l’État, et il n’y a rien à discuter ou à défendre. C’est un phénomène auquel il faut aussi réfléchir. Nous traversons sans aucun doute une période de réaction conservatrice et de discours ouvertement anti-féministes. Si la portée du féminisme n’était pas remise en question, il n’y aurait pas une réaction conservatrice aussi forte et spécifique. Il n’y aurait pas un tel antiféminisme».
«Ils sont en train de nous tuer»
«L’air du temps», c’est ainsi que l’écrivaine et journaliste Hinde Pomeraniec, l’un des soutiens de Ni Una Menos en Argentine, explique le phénomène. Pour la première fois, des milliers de personnes, au-delà du genre, aux quatre coins de la planète, sont descendues manifester contre un système oppressif qui a des conséquences directes sur leur vie.
«De nombreux auteurs disent que Me Too a tout déclenché à l’échelle mondiale parce que les accusations provenaient de personnalités très connues, ce qui leur a donné une énorme tribune. Nous ne sommes pas des célébrités; en Argentine, le déclencheur était un tweet auquel nous nous identifions et ça ne concernait pas une personne célèbre contrairement à ce qui s’est passé aux États-Unis. C’était une accumulation de nombreux petits événements qui se déroulaient en même temps».
Le tweet en question a été écrit par la journaliste Marcela Ojeda: «Actrices, politiciennes, artistes, femmes d’affaires, influenceuses... toutes les femmes... n’allons-nous pas hausser le ton? ILS SONT EN TRAIN DE NOUS TUER.» Elle le publie après avoir appris le meurtre de Chiara Páez, une adolescente de 14 ans enceinte qui a été enterrée dans une fosse par son petit ami de 17 ans. D’autres communicatrices se joignent à elle et organisent la première marche. Trois semaines plus tard, 250.000 personnes se rassemblent dans la ville de Buenos Aires; quelque 120 autres manifestations ont lieu ailleurs en Argentine. Comme l’explique la journaliste Paula Rodríguez dans son livre Ni Una Menos (Editorial Planeta), le lendemain de la manifestation, la ligne d’assistance téléphonique pour signaler les violences sexistes reçoit 13.700 appels, contre 1.400 habituellement.
Quelques chiffres et faits dans le monde

■ Plus d’1 femme et fille sur 10 âgée de 15 à 49 ans a subi des violences sexuelles et ou physiques de la part d’un partenaire intime au cours des 12 derniers mois.
■ Dans le monde, on estime que 736 millions de femmes -soit près de 1 sur 3- ont subi au moins une fois des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime, et/ou des violences sexuelles de la part d’une autre personne (30% des femmes de plus de 15 ans). Ce chiffre ne tient pas compte du harcèlement sexuel.
■ La plupart des violences contre les femmes sont perpétrées par le mari ou le partenaire intime actuel ou passé. Plus de 640 millions de femmes âgées de plus de 15 ans ont été confrontées à la violence perpétrée par leur partenaire intime (26 pour cent des femmes âgées de 15 ans et plus).

■ En 2021, le coût de la violence basée sur le genre à travers l’Union européenne a été estimé à environ 366 milliards d’euros par an. La violence à l’égard des femmes représente 79 % de ce coût, soit 289 milliards d’euros.
■ 15 millions d’adolescentes dans le monde (âgées de 15 à 19 ans) ont été forcées d’avoir des rapports sexuels. Dans la grande majorité des pays, ce sont les adolescentes qui sont les plus exposées au risque de relations sexuelles forcées (rapports sexuels ou autres actes sexuels forcés) de la part d’un partenaire actuel (mari, conjoint, petit ami) ou ex-partenaire.
■ Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 40 à 60 pour cent des femmes ont été harcelées sexuellement dans la rue. Dans une étude multi-pays, les femmes ont déclaré que ce harcèlement prenait principalement la forme de commentaires à caractère sexuel, d’une traque ou d’une filature, ou encore de regards insistants ou de propos salaces. Entre 31 et 64% des hommes ont confié s’être déjà livrés à de tels actes. Les jeunes hommes, les hommes instruits et ceux ayant subi des violences dans leur enfance étaient plus susceptibles de s’adonner au harcèlement sexuel dans la rue.
Source: ONU Femmes
Par Celeste del Bianco