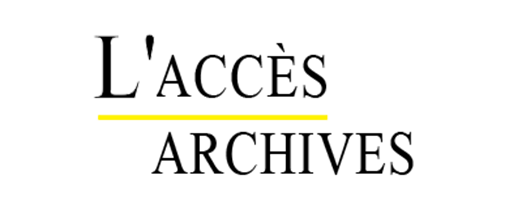Bachelor: Les écoles privées appréhendent
Il y a encore une semaine les écoles et universités privées ne savaient pas exactement à quoi s’attendre pour la réforme du bachelor, censée rentrer en vigueur en septembre prochain. Certaines se disaient dans le «flou total». «Nous devons déposer nos filières pour accréditation fin mars, alors que le cahier de normes pédagogiques du bachelor n’est pas encore validé...