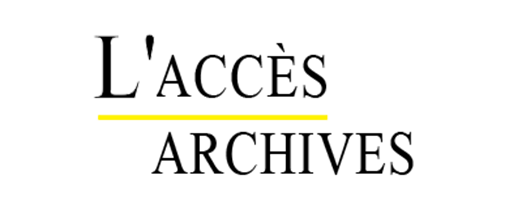Il y a 29 ans sur L'Economiste
Il était une fois le projet d’autoroute transmaghrébine. Dans son édition du 7 novembre 1991, L’Economiste s’attaque à l’un des plus vieux rêves d’intégration maghrébine. Et comme dans toutes les belles histoires, l’énigme est dénouée vers la fin et pas toujours selon nos envies...