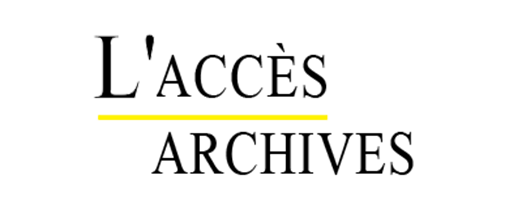La bi-bancarisation, un instrument au service du partenariat Afrique-Europe
Depuis le début de son quinquennat, Monsieur le président de la République française insiste sur la place que les diasporas doivent prendre dans la relation renouvelée avec l’Afrique. Les crises sanitaire et économique que nous traversons font apparaître aujourd’hui leur rôle crucial...