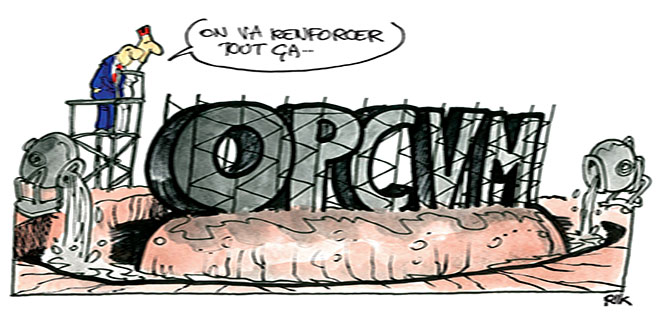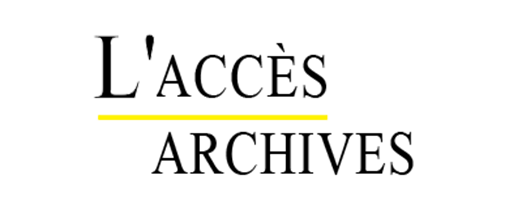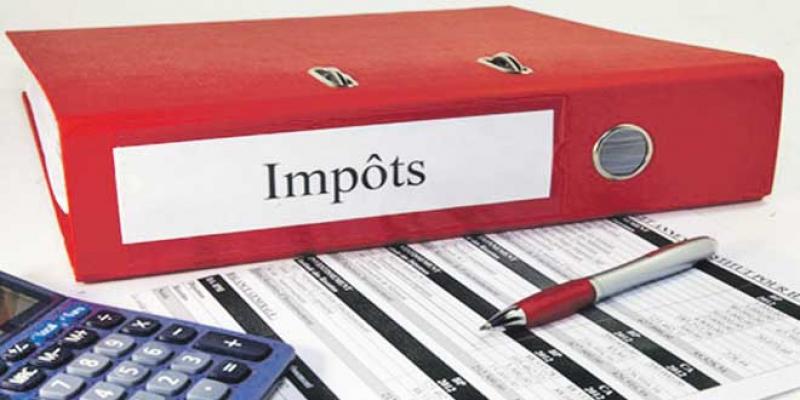Fruits et légumes: Forte perturbation de l’approvisionnement
Le couscous aux sept légumes relève, en ces temps de pandémie, des produits de luxe. Tout particulièrement à Casablanca où l’état de siège devrait se maintenir encore. Par rapport à la dernière semaine du mois de septembre, la flambée s’est emparée des fruits et légumes les plus consommés par les ménages. Des produits qui enregistrent, tout naturellement, une demande à la fois régulière et soutenue...