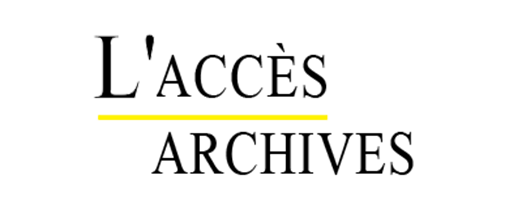Ancien haut fonctionnaire au Trésor, Lahsen Sbai El Idrissi est docteur d’Etat en économie. Il enseigne les finances publiques, publie aux éditions La Croisée des Chemins son dernier essai «Trésor public marocain – Une histoire, une vie». On signale d’autres publications: Éducation et économie, quelles relations (2013); Soufisme et économie solidaire au Maroc (2009); Soufisme et société (2007) ainsi que deux articles remarqués dans la revue Finances et bien commun, n° 22 et n°28-29 ou dans L’Economiste du 27 juillet 2020 (Ph. SEI)