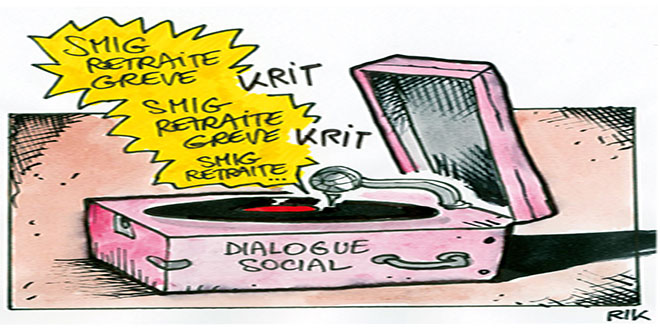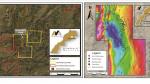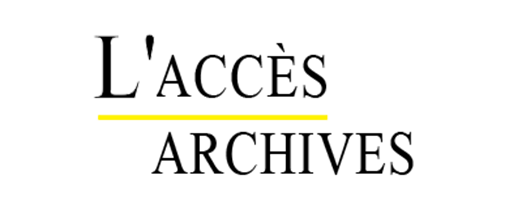Sans étudiants étrangers, des écoles en crise
Sur les dix dernières années, les écoles et universités privées ont plus que doublé leurs effectifs étrangers. De 3.289 étudiants en 2010, dont une majorité d’origine subsaharienne, elles sont passées à 7.941 en 2019, soit 40% du total des effectifs étrangers au Maroc...