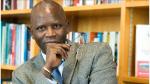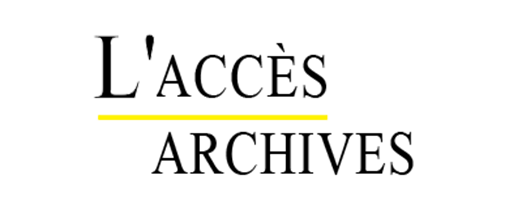Le partenariat Afrique-Europe: Quel renouveau dans l’après-Covid-19?
Le futur Sommet Union européenne-Afrique, prévu pour le mois d’octobre 2020, sera un moment d’évaluation du chemin parcouru par le partenariat entre les deux continents depuis le cinquième Sommet d’Abidjan de novembre 2017. Ce forum offrira l’opportunité d’apprécier la nouvelle et récente offre européenne de partenariat et l’implication de l’Union africaine (UA) dans la refonte des relations entre les deux continents...