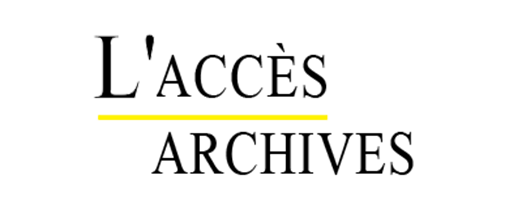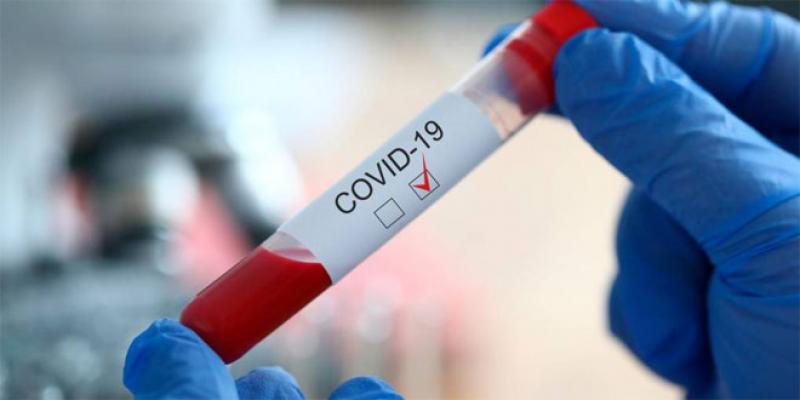Modèle de développement: Des pistes pour repenser les territoires
La refonte du modèle de développement implique une réinvention des modes d’implication des territoires dans la création des richesses. C’est ce qui ressort de l’analyse réalisée par le think tank Al Mountada, dans le cadre de sa contribution à la réflexion autour du nouveau modèle de développement...