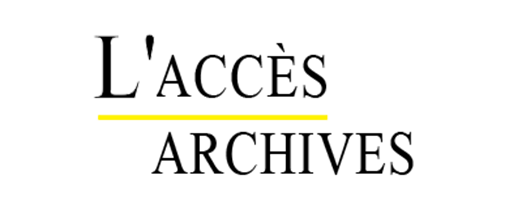Développement durable: Les bonnes intentions existent…
17 objectifs pour sauver le monde. L’ambition est grande. Trop grande? L’actualité, entre dérèglements sociaux et climatiques, montre tous les jours l’ampleur de la tâche. Les annonces chocs se multiplient. Déplacements de populations, conflits, montée des océans, ouragans et cyclones… Pour autant, le sursaut est encore trop frileux pour inverser la tendance...