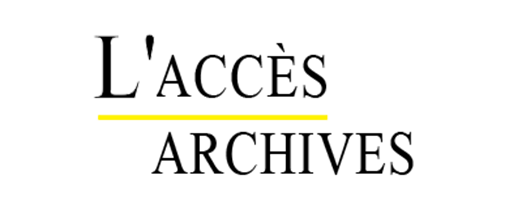Halieutis: Des avancées... mais en chantier
La stratégie Halieutis termine en queue de poisson! Dix ans après son déploiement, peu de ses objectifs ont été atteints (voir infographie ci-contre). Excepté l’aménagement des pêcheries pour une exploitation durable de la ressource, tous les autres indicateurs du secteur restent loin des ambitions initiales. Certains, notamment la valorisation et la consommation par habitant, ont stagné, voire reculé...